Les Bourgeois de Calais, de l’usage d’une sculpture / Nathanaël Picard
A/R Point Break 2020 – Sculpture d’usage, objet performé
I
D’aussi loin que je me souvienne, mes parents, ma sœur et moi passions tous les étés au moins une semaine, dans le pire des cas – sinon deux ou trois – dans la maison de mes grands-parents maternels à La Haute Escalles, au cœur du Parc Naturel d’Opale jouxtant Calais. « La Ville », comme on l’appelait. Avec une belle majuscule, comme il convient d’en apposer à tout ce qui nous fascine – à défaut, bien souvent, de nous dépasser. Quand ma grand-mère – puisque c’était elle qui gérait la maisonnée d’une main de velours dans un gant de fer – venait chercher ses petits-enfants jouant dans l’arrière-cour pour leur annoncer que nous partions à la Ville, il n’était jamais besoin de préciser de laquelle il était question.
Non pas qu’à notre âge nous nous en souciions.
Environ vingt minutes de voiture seulement nous séparaient de Calais, et il était d’usage que nous nous y rendions une fois par semaine, pour je-ne-sais quel prétexte avoué mis sur nos dos d’enfants – alors que nous n’aspirions qu’à finir nos courses de cagouilles ou poursuivre l’aménagement de notre cabane.
Nous râlions un peu, pour la forme peut-être, bien que cela n’ait jamais empêché mamie Annie de nous traîner dans les rues du centre-ville de Calais, passant toujours devant le majestueux beffroi et la place de l’hôtel de ville avant de nous rendre, comme de coutume, jusqu’au port puis de s’arrêter une fois pour toute à la plage où nous étions systématiquement gâtés d’une crêpe, d’une glace ou d’une quelconque viennoiserie achetant notre complaisance.
Calais en vérité ne m’a jamais plu, loin de là.
Pour le petit garçon de la campagne que j’étais alors, il y avait trop de gens, trop de bruits, trop d’odeurs, trop de mouvements, trop de bâtiments qui nous surplombaient et nous toisaient de leurs regards vides aux volets entrouverts.
Mais la plus mauvaise impression que j’avais m’était donnée par la statue trônant devant l’hôtel de ville, dans le petit parc fleuri au pied du bâtiment. Je pense avoir senti, avant même de savoir écrire, que ce qui se tenait devant moi devait porter de grandes majuscules. Les Bourgeois de Calais.
Pendant longtemps j’ai ignoré à quel point Rodin était célèbre, bien que son nom sonnât différemment dans la bouche des grandes personnes. A cet âge, je ne m’attardais pas sur les qualités des sculptures - quelles qu’elles puissent être au demeurant. Je ne regardais pas les détails, la finesse des traits, la ressemblance avec la réalité – encore moins le propos de l’artiste, ses éventuels parti-pris... ; c’était en soi une réalité. Inerte et terrifiante.
Je me souviens très bien de ces têtes et de ces épaules qui se découpaient sur le ciel du Nord, avec l’hôtel de ville en décor d’arrière-plan. J’avais l’impression de faire face à un bloc massif, comme si les personnages avaient été taillés à même le bronze. J’imaginais presque les outils monstrueux qui avaient creusé la matière, l’avaient grattée, traversée de part en part, comme le vent se faufilait à-travers les jambes et les corps figés reposant sur leur socle qui m’arrivait à hauteur de tête, rehaussés encore par le piédestal de marbre blanc. Plus nous nous approchions de la sculpture, et plus je devais lever la tête pour contempler ces visages austères, émaciés et menaçants – et dont même les pieds nus, juste sous mes yeux, m’avaient l’air de sortir des enfers d’une Histoire des plus sombres.
Ma grand-mère me demandait alors si je me souvenais de qui étaient ces gens – ce qui avait le don de m’exaspérer. C’était une leçon obligatoire qu’il me fallait chaque fois répéter – et ce fut un soulagement quand ma sœur fut en âge de répondre et subir ce fardeau à ma place. Bien qu’alors, je me vexais qu’on ne me demandât plus, et ne m’empêchais jamais de préciser tel ou tel élément que ma sœur omettait dans sa récitation.
Il s’agissait des nobles de la ville – dont l’un d’entre eux, Jean d’Aire, au regard si fier et au visage si mort, s’agrippait aux clés de la cité qu’il tenait dans ses serres – ont offert leurs vies pour sauver celles des autres habitants de Calais.
C’était à l’époque de la Guerre de Cent Ans, où la France se battait vaillamment contre les Anglais ; tout le courage et l’abnégation de la Patrie me semblaient reposer sur les épaules de ces illustres hommes qu’au fond de moi-même, à force d’éloges sur leur compte, je ne pouvais m’empêcher d’admirer.
1346. Un siège insoutenable. Une horde sanguinaire portant à sa tête un Edouard III dément et vengeur. Des bourgeois héroïques, renonçant à leurs vies pour sauver le peuple... Les images se succédaient dans ma tête à mesure que ma grand-mère, à force de détails et d’emphases, faisait revivre pour nous ces grandes figures du passé.
Lorsque faisant face à ses ancêtres, ma grand-mère à la voix tremblante d’émotion égrenait sa litanie, décrivant combien les temps étaient durs, et combien il fallut être fort et courageux pour résister au roi d’Angleterre et à son armée barbare, j’éprouvais toujours la même sensation que je ressentais le dimanche à la messe, à la lecture des Évangiles, la poitrine gonflée par des paroles divines qui m’abreuvaient. Sous les mots de ma grand-mère, la sculpture semblait s’animer, se voilant d’un mysticisme profond – et je pensais parfois apercevoir du coin de l’œil un bas de chemise se soulever sous l’effet d’un vent venu de plus haut.
Je me souviens en particulier d’une fois où, à l’issue de son monologue si théâtral,un homme au chapeau de feutre avait ajouté, avec une simplicité et une franchise outrageante à pareil moment : "mais, vous savez, ils ont été épargnés".
Difficile de décrire l’effet que me fit cette révélation, mais je fus en tout cas très surpris et impressionné de voir ma grand-mère s’emporter contre l’inconnu, au motif que cela ne retirait rien au prestige et à la bravoure de ces nobles seigneurs, et que nous serions aujourd’hui bien en peine de trouver pareilles âmes prêtes à se sacrifier pour les autres. Je n’étais pas bien grand, mais je perçus toutefois très clairement que cette dernière remarque était destinée au malpoli qui, aux yeux de ma grand-mère,faisait partie de ces tristes gens qui prenaient un malin plaisir à dénigrer la patrie et sa glorieuse histoire.
Le fait qu’elle se mura ensuite dans un silence des plus opaques et refusa de développer ce qu’avait dit le monsieur acheva lentement de déchirer le voile mystique qui recouvrait cette sculpture – bien que je n’apprisse que plus tard ce qu’il en était réellement.
Je ne fus donc pas si étonné de comprendre, à terme, que l’histoire de cet évènement étaient moins louable que ce que je croyais alors, et qu’elle répond, à l’image de l’histoire de la sculpture en soi, à une volonté d’usage politique.
Le 24 septembre 1884, Omer Dewavrin, maire de Calais, tient à commémorer cet épisode glorieux de reddition et propose au conseil municipal un monument qui représente les six bourgeois, symbole de l’abnégation universelle. A cette date, le port de Calais est en perte de vitesse et la ville est menacée par l’éventualité d’une annexion à la commune voisine de Saint-Pierre. Le rappel d’un illustre passé historique et l’asservissement de l’art offrent donc l’opportunité aux élus de réaffirmer leur pouvoir, hérité de celui, symbolique, de la ville.
Et de fait, la transmission de cet épisode en lui-même, s’intégrant dans le grand "récit national" si cher à ma grand-mère, ne répond qu’à cette fin. La première version de l’histoire est celle de Froissart, selon laquelle les bourgeois héroïques se sont levés de leur grès pour remettre les clés de la ville en même temps que leurs vies aux roi d’Angleterre. Celui-ci accepta finalement, à la demande de son épouse, la reine Philippa, d’épargner la vie des misérables.
Le récit fut ensuite repris et popularisé par Paul Émile de Vérone et les tenants de l’"histoire parfaite" comme exemplum virtutis, inscrivant l’histoire de France dans celle de ses rois. Le mythe gagna en ampleur grâce aux soins de la pièce de Dormont de Belloy, Le siège de Calais, qui triomphe en 1765, puis par le truchement des toiles de Jean-Simon Berthélémy dix ans plus tard. L’histoire se retrouve ainsi utilisée au profit, d’abord, de la Patrie française, puis, par la suite, de la République – voyant dansce mythe un moyen de "républicanisation" des bourgeois et l’abandon de "la voie monarchique". Ce légendaire national qui entre dans les manuels scolaires de la Troisième République atteint son apothéose en 1895 avec l’inauguration du
monument de Rodin, répondant là encore, comme mentionné plus tôt, à un usage politique.
Ironie de l’historiographie : on sait dorénavant que cet épisode de reddition n’était qu’un rituel auquel se soumettaient les bourgeois qui savaient, à l’avance, qu’ils ne risquaient pas plus leur vie dans cette pantomime qu’une comédienne interprétant Phèdre. Ou tout autre personnage de tragédie destiné à expier. Peu importe.
Quoiqu’il en soit, ce petit rappel historique a moins pour vocation de poser la question de la signification que celle de l’usage, pour reprendre les termes de Wittgenstein. En l’occurrence concernant cette sculpture de Rodin, on s’aperçoit que l’usage premier du monument, au-delà de ceux que nous aborderons ensuite, repose précisément sur sa signification – à savoir le sacrifice héroïque des bourgeois. Et si usage il y a, c’est qu’il tend vers un but : celui, ici, de réaffirmer le pouvoir du politique à l’échelle nationale ou locale quitte, pour ce faire, à mystifier l’histoire. Par conséquent, plus que relevant d’un simple usage commémoratif, la sculpture des Bourgeois se révèle propagandiste, à l’instar de la statuaire des Romains.
II
L’épisode de l’homme au chapeau soucieux de contribuer à l’histoire de ma grand-mère fut, je crois, l’une de nos dernières visites à Calais. Dès lors, peut-être aussi parce que nous grandissions et affirmions davantage notre volonté, nous ne nous rendîmes plus que rarement à la Ville – si bien que cette sculpture demeura en l’état dans mes souvenirs. Mais rendant visite à mes grands-parents, je suis retourné à Calais l’année dernière – et si le centre-ville avait bien changé, la sculpture, elle, continuait de braver le temps.
La pluie fine battait les pavés de la place de l’hôtel de ville et nimbait les figures d’un halo d’infimes éclats de gouttes d’eau. La pluie ruisselante sur ces corps décharnés en soulignait des contours que ma mémoire, ou mes yeux d’enfants, n’avaient pas imprimés.
Au regard instinctif je préférai celui de l’intelligence et observai dans le détail les bras pendants et les pas lourds, la lassitude et le désespoir qui transparaissaient dans les gestes et les attitudes, les lèvres serrées, les yeux clos, déterminés ou éteints, la posture de ces corps vifs et nerveux, de ces dos, le mouvement écorché d’un pied qui se lève, résolu, ou d’un bras figé pour l’éternité.
A mesure que je tournai autour de la sculpture, autour de ces vides traversant et de ces pleins qui obstruaient le regard, je me surpris à tenter d’observer du coin de l’œil les bas des chemises tombantes, dans l’attente qu’un pli se gonfle sous l’effet d’une brise qui ne surviendrait jamais plus.
L’impression que me fit le monument, après ces quelques années sans le voir,changea du tout au tout. Peut-être à cause de la pluie, de ma taille – nul besoin à présent de lever les yeux au ciel au risque de se rompre la nuque – ou de ce que j’appris entre-temps de l’histoire des bourgeois de Calais et celle de cette sculpture – et des usages qui en furent faits.
Pourtant, il ne revient jamais à chacun.e de faire une expérience singulière, bien que propre à l’individu, d’une œuvre d’art. En témoigne le domaine de la culture, où cette œuvre prit une forme littéraire sous la plume de Rainer Maria Rilke, qui en donna une description empreinte de poésie et d’admiration, autant pour l’artiste que pour les hommes qui y sont célébrés – assimilant ainsi la représentation au sujet représenté.
Source d’inspiration pour l’écrivain, elle le fut aussi pour le dessinateur, Glen Keane, créateur et animateur de la Belle et la Bête pour Disney. Dans un entretien1, il se confie sur la scène de transformation de la Bête, qui s’élève dans les airs, la caméra tournant autour de ce corps monstrueux en mutation ; l’idée lui est venue de l’expérience qu’il fit de la sculpture des Bourgeois et des croquis qu’il en réalisa, notamment les dos qu’il trouvait "particulièrement puissants".
Usage relevant moins de l’inspiration provoquée que de la matérialité de la pièce,la groupe de rock Les Bourgeois de Calais, originaire de la région, se fit photographier sur le socle de la sculpture pour la pochette de leur premier album dans la des années 60 – ignorant probablement que tel était un des souhaits de Rodin de placer le groupe très bas "pour laisser au public pénétrer au cœur du sujet, comme dans les mises au tombeau d’églises ou le groupe est presque par terre"2.
Car s’il est bien une question que soulève cette sculpture, c’est avant tout celle du socle et de son usage.
Traditionnellement, le socle est le support d’une statue ou d’une sculpture qui sert à la stabilité et à la présentation de l’ensemble, assurant ainsi une fonction mécanique en soutenant le poids de l’objet qu’il supporte. Sa fonction première est de servir d’intermédiaire entre l’objet et le sol – et par là de la mettre en valeur. Induisant la verticalité, en écho à la position du spectateur, le socle est comparable au cadre pour la peinture qui orne et décore l’œuvre ainsi présentée. Le socle enfin dirige le regard et facilite l’accès visuel à l’œuvre, isole la sculpture de son environnement. Mais paradoxalement, il met l’œuvre à distance en la sacralisant, conférant un caractère glorieux à l’objet sculptural.
Jusqu’à l’époque moderne, le socle est purement fonctionnel, même si son style s’adapte à la sculpture à laquelle il est consacré. Avec Les Bourgeois de Calais, Rodin, le premier, ébranle les fondements de cette tradition du socle, préférant la pratique perceptive de la sculpture à son usage fonctionnel, au profit d’une expérience esthétique. C’est précisément ce qui fait des Bourgeois une sculpture dite d’usage, selon la définition qu’en donne Émilie Perotto3.
Pourtant, comme en témoignent les premières maquettes réalisées par Rodin autant que ces nombreuses correspondances sur le sujet, un autre choix se présentait à lui : élever la sculpture sur un socle très haut, de 5 à 6 mètres, voire sur "une tour carrée, tout au bord de la mer, de la largeur de la base, avec de simples murs taillés, haute de deux étages", selon les propos de Rilke en 1903 et devenu le secrétaire de l’artiste deux ans plus tard4.
Les Bourgeois de Calais étaient donc pour Rodin l’occasion d’expérimenter des solutions radicales sur la question du socle, selon qu’il souhaitait mettre l’accent sur les sentiments des personnages – au profit d’un usage perceptif – ou sur leur héroïsme – dans une optique fonctionnaliste d’une sculpture aspirant à l’universalité ; en attestent les nombreuses répliques déjà réalisées à la mort de l’artiste (Copenhague, Mariemont, Londres et Venise).
L’œuvre ayant été commanditée par la ville de Calais, celle-ci trancha sur la question du socle et la sculpture est aujourd’hui présentée à un peu plus d’un mètre au-dessus du sol, ne satisfaisait ainsi aucune des deux options de Rodin. Mais le socle ne fut pas la seule pomme de discorde entre la ville et l’artiste, puisque le sculpteur choisit de présenter ses figures au sein d’une structure cubique, et non pyramidale, comme il était d’usage pour les monuments aux morts.
Autrement dit, Les Bourgeois de Calais remet en question la notion d’usage en tant que pratique (de l’œuvre, de sa portée) et en tant que tradition ; un objet usuel est aussi bien un objet ayant une fonction qu’un objet dont on a l’habitude. Ce qui n’est pas sans souligner une tension fondamentale de la sculpture d’usage.
Pour Émilie Perotto en effet, "pour que [la sculpture d’usage] soit efficiente, il semblerait qu'elle ne doive pas faire partie de notre temps quotidien comme les objets,mais rester exceptionnelle en s'offrant à l'expérimentation par intermittence. La sculpture d'usage peut voisiner avec l'objet fonctionnel, à partir du moment où elle se place en décalage dans notre quotidien, ouvrant ainsi un autre espace-temps qui active la conscience de notre corps ici et maintenant5". D’où la différence fondamentale opérée par les tenants de la sculpture d’usage entre fonctionnalité et l’usage. Et Isabelle Plat d’affirmer que "si la sculpture d’usage se contentait de répondre à une fonction, elle serait un pur objet de consommation facilement remplaçable6". Mais consommation il y a pourtant, puisqu’à l’instar de ce qu’affirme Sylvie Coëllier : "parler d’usage pour l’art suggère son usure, un affaiblissement de l’aura dont nous aimons toujours le doter, une diminution de sa valeur spéculative d’objet de collection7. A la place de cette valeur spéculative, c’est une valeur poétique et réflexive qui est conférée à la sculpture dont on fait expérience.
La sculpture d’usage apparaît ainsi comme l’héritière des changements de fond qui caractérisèrent le passage de la modernité à la postmodernité, en tant que la sculpture est moins appelée à être cette création éthérée et intemporelle qu’un objet "vivant" dont la résistance fait place à l’adaptation, et la résistance à l’évolution.
Guillaume Logé voit dans ce qu’il appelle un "art de l’Anthropocène", une "Renaissance sauvage" caractérisée par le "développement d’une nouvelle conscience esthétique et éthique8", à l’instar de ce que propose par exemple Veit Stratmann avec son œuvre Une Colline (2012) faisant appel à une communauté locale pour rehausser avec de la terre tous les 30 ans un site de stockage nucléaire. Ce rituel intergénérationnel tend ainsi à garder la mémoire des risques et considère l’usage comme antidote symbolique à la folie et à l’oubli collectif.
Face au monument toujours drapé d’une pluie fine, je coupe souvent cours aux pensées théoriques qui me viennent désormais ; on pourrait facilement se laisser aller à concevoir que cette sculpture ait, à sa manière, préfiguré le concept branché d’esthétique relationnelle, qui n’emprunte que trop – ou trop peu – aux théories de l’esthétique des penseurs anarchistes.
Ainsi posée sur son maigre socle et son imposant piédestal, je garde l’idée qu’unetelle sculpture, bien qu’offrant moult pistes à penser l’usage, n’aspire qu’à être contemplée. Bien qu’elle ait pu pendant un certain temps inspirer une ferveur patriotique, il ne reste aujourd’hui qu’une admiration pour l’œuvre en soi, loin de tout contexte historique aujourd’hui complètement ignoré par les foules de badauds qui lui passent devant le temps de la photographier pour l’éternité d’un battement de secondes au seul usage de leurs disques durs qu’ils ne consulteront jamais, photo perdue au milieu des millions d’autres et coincée entre un château de sable en Espagne et une vaine tentative de redresser la tour de Pise.
Nathanaël Picard
texte en relation avec celui d'Émilie Perotto publié dans le catalogue Assiégeons ! consultable ici
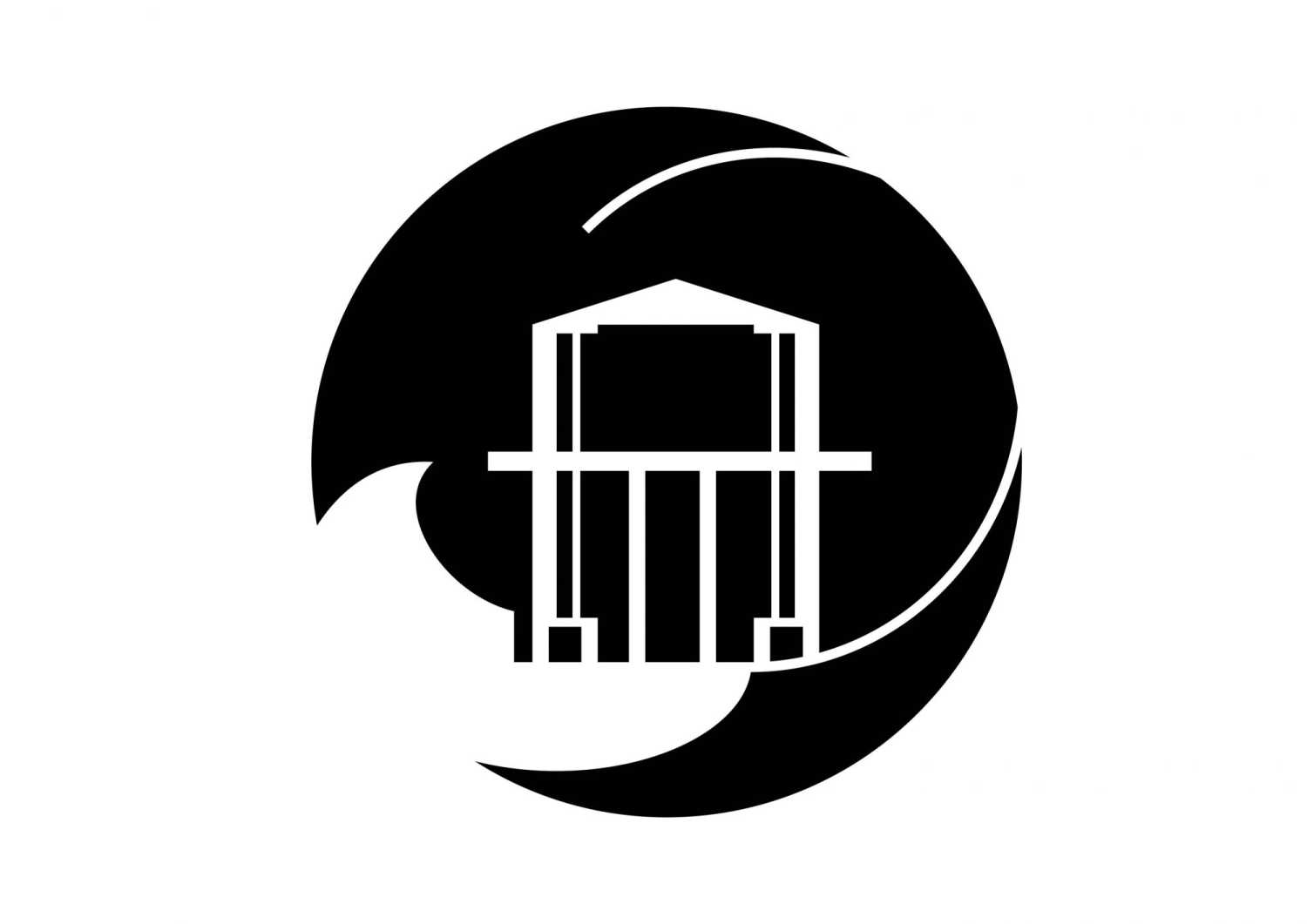
Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.
Veuillez effectuer une mise à jour.