Bifurquer en architecture
Choisir l’essentiel : ouvrir à l’éclectisme les jeunes architectes

Entretien avec Cédric Libert, nouveau directeur de l’Ensase, l’École nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne.
Qu’est-ce qui vous a amené à changer de vie, quitter Bruxelles pour devenir directeur de l’Ensase ?
Récemment, toutes les écoles d’architecture ont dû se re-définir. Cet exercice consistant à « se définir », donne beaucoup de projets très mièvres qui essayent de négocier le chou et la chèvre en même temps.
Bizarrement, le projet qui a émergé de cette obligation de faire comme tous les autres ici à Saint-Étienne a donné quelque chose que je trouve vraiment incroyable. Un nouveau programme a été monté par une partie des enseignants, imaginé, négocié, validé, qui met en lumière ce qui existait déjà, le ré-articulant.
Ce projet pédagogique, je pense réellement qu’il est visionnaire. Il met en lumière le fait qu’en amont de tout projet architectural, il y a la question du contexte : qu’est-ce qu’on fait ? Quel est le cadre à l’intérieur duquel s’inscrit l’architecture ? Cela consiste à rappeler que les convictions du projet architectural, les questions du pourquoi faire, que faire et comment faire, sont toutes importantes.
C’est là-dessus que j’ai décidé de candidater au poste de directeur de cette école, suivant aussi différents conseils d’enseignants et du ministère. C’est un levier, une base, une idée, un vrai projet au sens de « lancer un peu plus loin », se dire que c’est par là qu’on va. Les acteurs présents n’en réalisent pas toujours tous la valeur.

Quel est ce nouveau projet pédagogique de l’École d’architecture de Saint-Étienne ?
En amont de tout projet, il y a la question du contexte : qu’est-ce qu’on fait ? Quel est le cadre à l’intérieur duquel s’inscrit l’architecture ?
Les questions – extrêmement justes – du projet et de la conviction du projet ; la question du faire et la question du pourquoi faire, que faire et comment faire, sont toutes importantes.
Le fait est que c’est l’histoire de Saint-Étienne, de son école d’architecture. Il y a cette dualité entre une approche linguistique, conceptuelle, artistique, puisant dans le champ de l’art et la littérature, qui interroge du coup les contours de l’architecture, et une autre dimension très concrète sur le projet, la dimension du faire : faire un projet c’est mettre les mains dedans, c’est fabriquer des projets réalistes, construits, etc.
Ce nouveau programme pédagogique reconnaît l’existence de ces deux modes de pensée qui existaient à l’école. Ontologiquement, c’est quand même deux visions du monde… La question narrative de l’architecture c’est penser des mondes, faire appel à la littérature, à l’art pour interroger l’idée d’habiter le monde.
C’est ça l’identité de l’École d’architecture de Saint-Étienne, telle qu’elle est depuis longtemps. Historiquement, l’école n’a jamais que 50 ans donc la mémoire est là, ces questions-là du faire, du pourquoi faire, des langages, sont là depuis le début.
Les jeunes ne sont pas là pour apprendre à construire des bâtiments.
Ce projet découle de l’Histoire de l’école ?
Il y a deux grandes figures historiques de l’Ensase. La première est Patrick Berger – Le grand professeur de Lausanne de ces 25 dernières années, a commencé ici – il a véritablement fondé une pédagogie sur le projet, la méthode du projet. La deuxième figure est Georges Lebaube, que je découvre, qui lui installe des recherches avec les étudiants et étudiantes par le dessin avec ce qu’il appelle le chemin du dessin. Ce sont les auteurs de livres de référence pour l’école, c’est presque un évangile, tout y est ! Tout est écrit au départ par les deux premiers apôtres. Au bout de 50 ans, c’est quand même ça qui continue d’exister. Cette identité, imaginaire, manière de faire, on la retrouve aussi concrètement dans la structure de l’école : dans le LMD (Licence Master Doctorat), dans la manière de travailler sur des doctorats, la structure de l’école en master… tout est là, très cohérent.
Globalement, c’est mon grand sujet aussi, ma thèse interrogeait déjà ça.

En quoi ce projet pédagogique original vous a-t-il attiré ?
Depuis pas mal d’années, en tant qu’enseignant de diplôme à Versailles, je récupérais tous les projets un peu bizarres, un peu étranges, et précisément tous les étudiants et toutes les étudiantes qui n’étaient pas intéressés de faire des projets, mais interrogeaient la condition du projet. C’est une méta-question en fait. Ce n’est pas directement « être architecte », mais s’intéresser à « pourquoi être architecte », comment être architecte… C’est le projet qui a été déposé à l’Ensase. Je le trouve absolument incroyable. C’est extrêmement précis et précieux pour les jeunes générations. Ce que je ressens de leur part, ce n’est pas tellement la volonté d’être ou ne pas être architecte, mais c’est la volonté d’interroger ce que c’est que l’architecture, et ce que c’est qu’être architecte.
Au 20e siècle on est quand même passé de la « machine à habiter », anthropocentriste, à la notion d’habiter le monde, réagencer de multiples existences, avec Bruno Latour notamment. Il parle de « la grande bifurcation » : ce moment au 18e siècle où l’on sépare la destinée humaine de celle du reste des espèces, cette grande bifurcation qui va mener au projet moderne…
Il y a le poème de l’angle droit de le Corbusier, la figure de « l’homme nouveau »… C’est la grande théorie, le grand projet moderne, d’émancipation de la nature. Ce projet est anthropocentré, c’est un projet de domination des autres forces de la nature. Il faut quand même bien reconnaître qu’on s’est planté, je ne peux pas le dire autrement (rires). Qu’est-ce qu’on en fait de ce grand projet qui a échoué ? Il y a le courant post-moderne qui a essayé de se rassurer comme avec des petites madeleines de Proust, qu’on se met dans la bouche en se disant « ça va aller, on va laisser passer le truc », mais ça n’a pas mené à grand-chose. Les philosophies contemporaines, les manières de réfléchir le monde, par exemple le travail d’Emanuele Coccia, réinscrivent la question du vivant dans notre mode d’existence, sachant qu’on a fait beaucoup de conneries. En architecture aussi la question du vivant se pose.
La certitude moderne est encore présente, amenant une envie pour certains de poser sur la table un récit mono-orienté, pseudo-rassurant, mais complètement faux par rapport à la complexité du monde. Pour ma part, je trouve très intéressant de pouvoir passer d’un registre de pensée à un autre, même s’ils peuvent paraître incompatibles. Tout ça se retrouve chez Edgar Morin, la « dialogique »1, tout ce que j’ai découvert pendant mes recherches, intuitivement je le savais déjà, mais le fait de pouvoir mettre des mots dessus permet de passer facilement d’un groupe à l’autre, ne pas être dans des positions de combat, mais plutôt dans des positions d’intelligences complexes. Je pense que les jeunes générations, les étudiants et étudiantes, ils l’ont ça, intuitivement. Ils sont nés avec ça, dans une époque où, comme ils n’ont pas connu le projet moderne, n’ont pas eu la pédagogie que nous avons pu avoir, où des certitudes étaient balancées, ils sont nés d’une part avec une souris dans la main, mais aussi dès le départ le fait de savoir que le monde était complexe, compliqué, qu’on allait pouvoir entendre une chose et son contraire au cours de la même discussion, et grosso modo le fait que personne ne sait ce qu’il fallait faire dorénavant, c’est une génération qui comprend intuitivement ces questions.
Les étudiants en école d’architecture cherchent aujourd’hui à avancer des réponses à ces questions ?
Exactement. Le devoir de l’école est précisément de leur fournir, non pas des réponses parce que personne ne les a les réponses, mais au moins des éléments, des outils, de leur donner des trucs qu’ils vont pouvoir utiliser pour se faire leurs propres réponses, leurs propres explorations, qui vont les amener à cheminer. Parce que trouver une réponse c’est très moderne comme idée, « la réponse » signifierait que l’on conclut. L’Histoire de la Science c’est ça aussi : aller vers quelque chose, dans un chemin qui n’est jamais terminé. Et plusieurs centaines d’années plus tard, on va remettre en question les hypothèses qui fondaient les croyances du monde. Les scientifiques ne vont pas s’entretuer. Ils disent « merci pour l’état d’avancement, cela dit, maintenant on se demande si ça n’est pas à revoir, et on fait autre chose ».
Je pense que ce registre de pensée qui permet juste de dire « c’est très compliqué, on n’en sait rien » le simple fait de savoir qu’on ne sait pas, qu’on ne comprend rien, qu’il y a plusieurs existences, très différentes les unes des autres, qui coexistent, que l’une peut dire le contraire de sa voisine tout en étant complémentaire… c’est ça le mode contemporain. Il faut être assez blindé pour pouvoir l’aborder sans être complètement névrosé. C’est ça qu’il m’intéresse de développer avec des groupes d’étudiants et enseignants : mettre en place des protocoles, des expériences, plus que d’imaginer des réponses.
Concrètement comment cela se met-il en place ?
Par exemple, j’ai fait ma thèse avec Philippe Potier, un type extraordinaire, on était une brochette de 6 à avoir été à la fois ses cobayes, mais aussi ses maîtres à penser. Il a sorti un bouquin il y a 1 an ou 2, on voit bien qu’il ne nous a rien dogmatisé : il nous a appris des structures, des méthodes, il a fait remonter des questions, et on a fait remonter des choses qu’il réutilise dans son livre. Il n’y a pas de rapport de hiérarchie en fait, il y a un rapport de construction et co-construction. Malgré tout, notre histoire à 6 est différente, on s’est retrouvés là-bas par hasard, avec tous des raisons différentes d’être auprès de Philippe Potier. Son grand compte à régler – car on a tous des comptes à régler – c’est celui de la systémique originelle de la thèse, qui est un pur produit du 19e siècle, post-éclectique et pré-moderne. Un sujet de doctorat c’est une hypothèse, une thèse, un développement, une synthèse, une conclusion, etc. C’est un mode de pensée linéaire qui va de A à B, c’est un cercle fermé, donc un projet très moderne. Le principe même de la thèse est un système qui n’ouvre rien. C’est extrêmement punk de dire ça dans le milieu académique, parce que ça ébranle tout le système académique. Mais ce que cherche Philippe Potier c’est de remettre en question la structure même de la thèse pour essayer autre chose, des ouvertures… qui témoignent de la complexité du monde. Pour lui, une thèse est un prétexte pour rencontrer ses pairs si on le souhaite, et essayer d’échanger sur un système.
Dans nos 6 thèses, on trouve des hypothèses, mais aucune réponse, on n’apporte aucune solution, on ne dit pas « face à tel problème, voici la bonne réponse ». On a tous identifié des sujets, les thèses peuvent se lire un peu dans plusieurs sens, et c’est plutôt une digression vers une ouverture qu’une conclusion-fermeture.
Quel était le sujet de votre thèse ?
La clé de voûte de ma thèse est la question de l’éclectisme, non pas comme style, mais comme manière de penser, l’éclectisme grosso modo est la pensée de la multiplicité : on multiplie les points de vue, de façon très différenciée. L’éclectisme c’est plein de choses différentes ensemble. Initialement, c’est la pensée de la précision, la précision du choix, la précision d’un autre choix, fût-il antagoniste, donc c’est l’anti-dogmatisme.
Le sujet part de la fin des grands récits modernes historiques… Nous sommes la première génération pour qui le « progrès » est presque une injure. Le 20e siècle cristallise deux ruptures : la fin des grands projets modernes, mais aussi la fin de la réaction post-moderne. On est dans un espèce de néant conceptuel, idéologique, dogmatique… On est tous au milieu d’un champ de bataille, pris entre deux feux… écologie et économie par exemple, etc. La condition contemporaine est bercée de contradictions ; aucun grand récit ne permet d’y répondre. L’hypothèse est de dire : face à la fin de ces grands récits, peut-on réactiver la possibilité de multiplicité de lectures du monde, d’antagonisme ? C’est mon point de départ, sachant que ce qui m’intéresse ensuite c’est de tirer l’éclectisme. A priori, il est mort avec la Révolution française. L’encyclopédie d’Alembert et Diderot est en fait un projet littéralement éclectique. À l’entrée « éclectisme » il y a 23 pages, c’est lui-même une mise en abîme. Ma thèse n’est pas sur une approche historique de l’éclectisme, mais met en lumière le fait que ce projet a disparu de manière assez visible, parce qu’il a été remplacé par la modernité, un projet qui était très univoque. Au fond, il a peut-être subsisté, on en trouve des ersatz contemporains : c’est la question du dialogique chez Edgar Morin, la question d’anthropophagie au Brésil, la question cosmopolite, la question autour d’Édouard Glissant avec la pensée créole… Globalement il s’agit de ré-interroger les systèmes de pensée en art, en architecture et en philosophie, en convoquant un mécanisme de pensée qui est plutôt ouvert, multiple et non fermé et certainement pas dogmatique.
Je conclus ça par une hypothèse de travail autour de la question des expositions, la question curatoriale, autour d’Harald Szeemann, le grand-père spirituel des curateurs et curatrices, en imaginant que le langage de l’exposition est quelque part une forme d’itération contemporaine de l’éclectisme, en fabriquant des récits multiples. Harald Szeemann est vraiment fascinant, j’ai regardé plus spécifiquement trois de ses expositions, qui ne sont pas les plus connues, où il a précisément exploré cette dimension-là.
Pour le dire simplement : le chemin linéaire moderne est mort, les grands héros sont morts aussi : qu’est-ce qu’on fait ? J’essaye d’émettre, modestement, l’hypothèse qu’il faut peut-être rouvrir la boîte à de multiples idées, essayer de comprendre que le monde dans lequel on est est tellement antagoniste, opposé, pluriel, qu’il faut peut-être trouver le moyen d’y réagir, de cette manière-là aussi. On peut en tout cas se poser la question.





Aujourd’hui qu’est-ce qui vous semble parler d’architecture autrement ? Qui suivez-vous avec attention ?
Je suis un grand boulimique. L’éclectisme c’est pouvoir se dire qu’on aime les frites et le chocolat, qu’on n’est pas obligé d’être salé ou sucré, qu’on peut passer de l’un à l’autre… Donc il y a énormément de choses qui m’intéressent, et aussi énormément de choses qui ne m’intéressent absolument pas. Tellement de choses inintéressantes circulent… Il faut qu’on arrête de bétonner, tout bitumer, on doit recommencer à faire passer l’eau à travers les strates. Développer des telles surfaces imperméables…
Pas mal d’agences assez jeunes m’intéressent, mais par rapport à l’ensemble de la production c’est un nombre assez restreint. En général, je m’intéresse à des petites agences qui ne cherchent pas à produire un langage total et uniforme, à fabriquer une œuvre, mais qui arrivent à démultiplier des manières larges d’interroger le projet d’architecture, par le client, le contexte, le site, la réutilisation… qui produisent souvent des langages architecturaux étranges, qui ne sont pas le fruit d’une recherche égotique ou d’une recherche sur un nouveau langage, mais qui sont plutôt le fruit d’une extrême intelligence. Leurs choix subjectifs, de combinaisons de paramètres, arrivent à dépasser l’a priori académique, et produire des projets qui sont des petites réponses. L’architecte belge, qui enseigne à l’ETH de Zurich, Jan de Vylder, pour moi fait du « bricolage savant ». Il est toujours vexé quand je dis ça, mais pour moi c’est très positif. Par moment il se caricature un peu lui-même maintenant, mais ces premiers projets sont exceptionnels. Comme ils sont faits pour les copains, la famille, on voit qu’il n’y a pas beaucoup de moyens financiers, c’est là qu’il faut être malin. Il est brillantissime : tout d’abord c’est extrêmement bien construit, tout est à sa place, ensuite c’est aussi un constructeur par la gestion du tableau Excel, avec une maîtrise du temps de la construction, du suivi des différents entrepreneurs, et enfin la 3e corde à son arc est le fait qu’il n’a aucun a priori formel. Donc, ça produit des résolutions surprenantes, car totalement hors systèmes, hérétiques par moments. C’est l’un des premiers qui va réutiliser les structures tubulaires d’échafaudages dans des intérieurs de maison, car ça ne coûte rien du tout, mais aussi laisser apparents des tubes qu’on appelle des étançons – qu’on retire en général. Cela produit des espaces plastiquement étonnants, d’où le bricolage savant, extrêmement bien agencé. Il est pour moi extrêmement contemporain, surtout dans ses premiers travaux, car il répond à des questions actuelles, de copains, couples avec jeune(s) enfant(s) qui n’ont pas beaucoup de moyens, et qui doivent habiter, et il le fait de manière extrêmement juste. C’est un de ceux que j’aime bien.
J’ai un grand pied dans l’art aussi, ça m’influence beaucoup parce que je trouve que le langage utilisé par les artistes pour raconter le monde dans lequel on vit me parle.
Je suis par exemple Shumon Basar avec qui j’ai beaucoup bossé il y a quelques années, qui a un travail tout à fait personnel, curatorial, sur les conditions contemporaines, qui pour moi l’un des plus brillants penseurs, il est trash par moments donc assez drôle, l’ensemble de ses neurones est en permanence sollicité pour regarder le monde dans lequel on vit. Il a un Instagram tout à fait extraordinaire, c’est son vrai outil.
Il y a aussi le collectif d’artistes Apparatus 22 à Bruxelles, qui sont très bons sur le rapport au temps présent.
Il faut que les architectes arrêtent de faire des bâtiments, l’architecture peut être autre chose.
Luc Deleu, un artiste architecte belge, un lundi matin lors d’une conférence à Versailles a mis une bombe au milieu de la pièce. Il a dit : « Au cours du 20e siècle on a construit plus qu’au cours de toute l’histoire de l’humanité précédente. Et au cours du 21e on a déjà construit plus qu’au cours du 20e. En fait, on sait d’ores et déjà qu’on a pas les ressources pour maintenir ce qu’on a déjà produit. On a déjà produit plus d’objets qui seront des ruines, que d’objets qui pourront être entretenus pour durer ! On a tout simplement pas assez d’énergies ni les ressources nécessaires pour maintenir ce qu’on a produit. Le futur de l’architecture n’est pas dans la construction. » Et lui il dit ça dans une école d’architecture, un lundi matin à 9h, face à des jeunes de 20 ans. J’ai vu que les étudiants tiltaient immédiatement, car les jeunes ne sont pas là pour apprendre à construire des bâtiments. »
Un lundi matin, dans une école d’architecture, Luc Deleu (artiste architecte belge), a déclaré : “au cours du 20e siècle, on a construit plus qu’au cours de toute l’histoire de l’humanité précédente. Et au cours du 21e on a déjà construit plus qu’au cours du 20e. En fait, on sait d’ores et déjà qu’on a pas les ressources pour maintenir ce qu’on a déjà produit. On a déjà produit plus d’objets qui seront des ruines, que d’objets qui pourront être entretenus pour durer ! On a tout simplement pas assez d’énergies ni les ressources nécessaires pour maintenir ce qu’on a produit. Le futur de l’architecture n’est pas dans la construction.” Une bombe au milieu de la pièce.
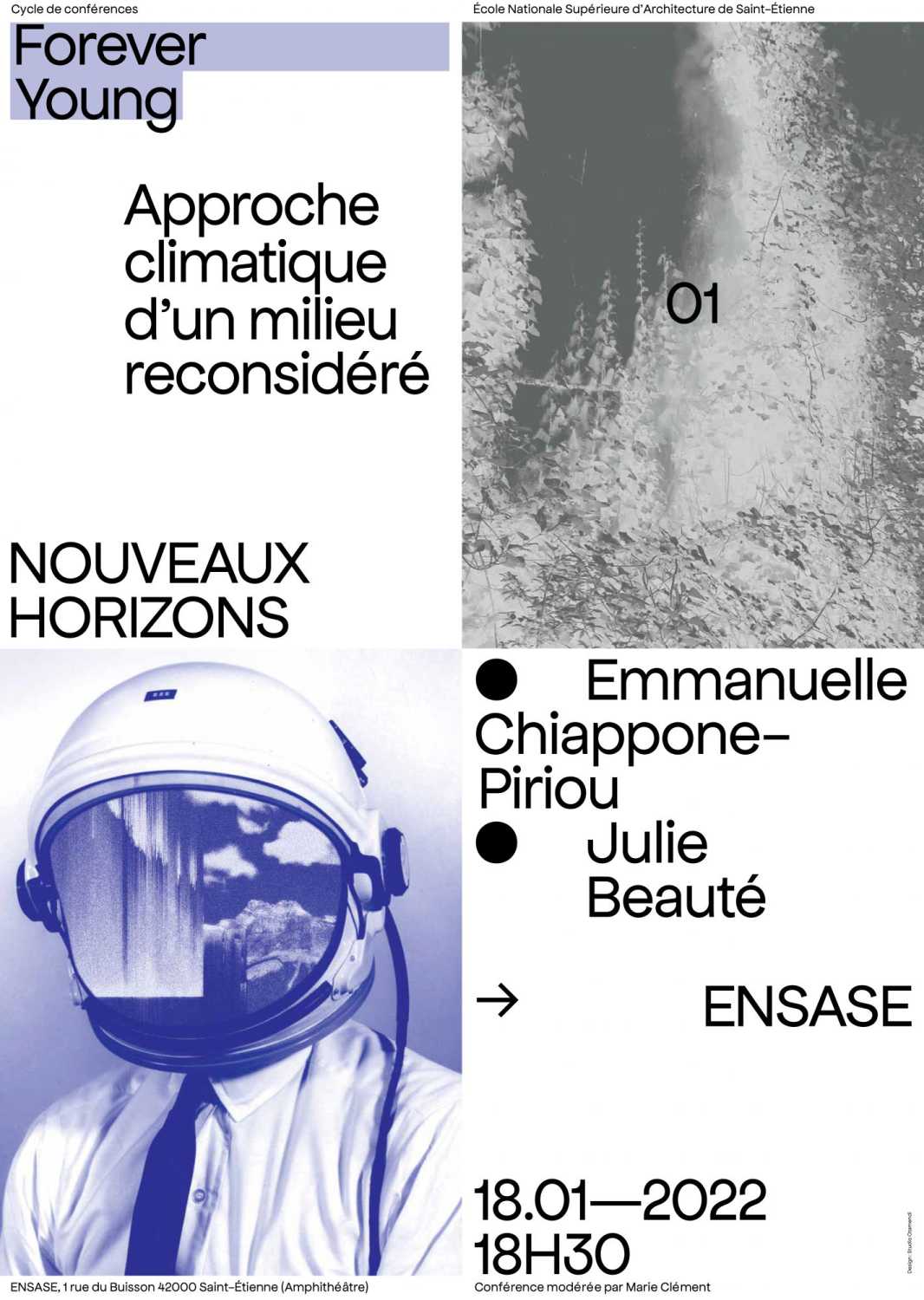
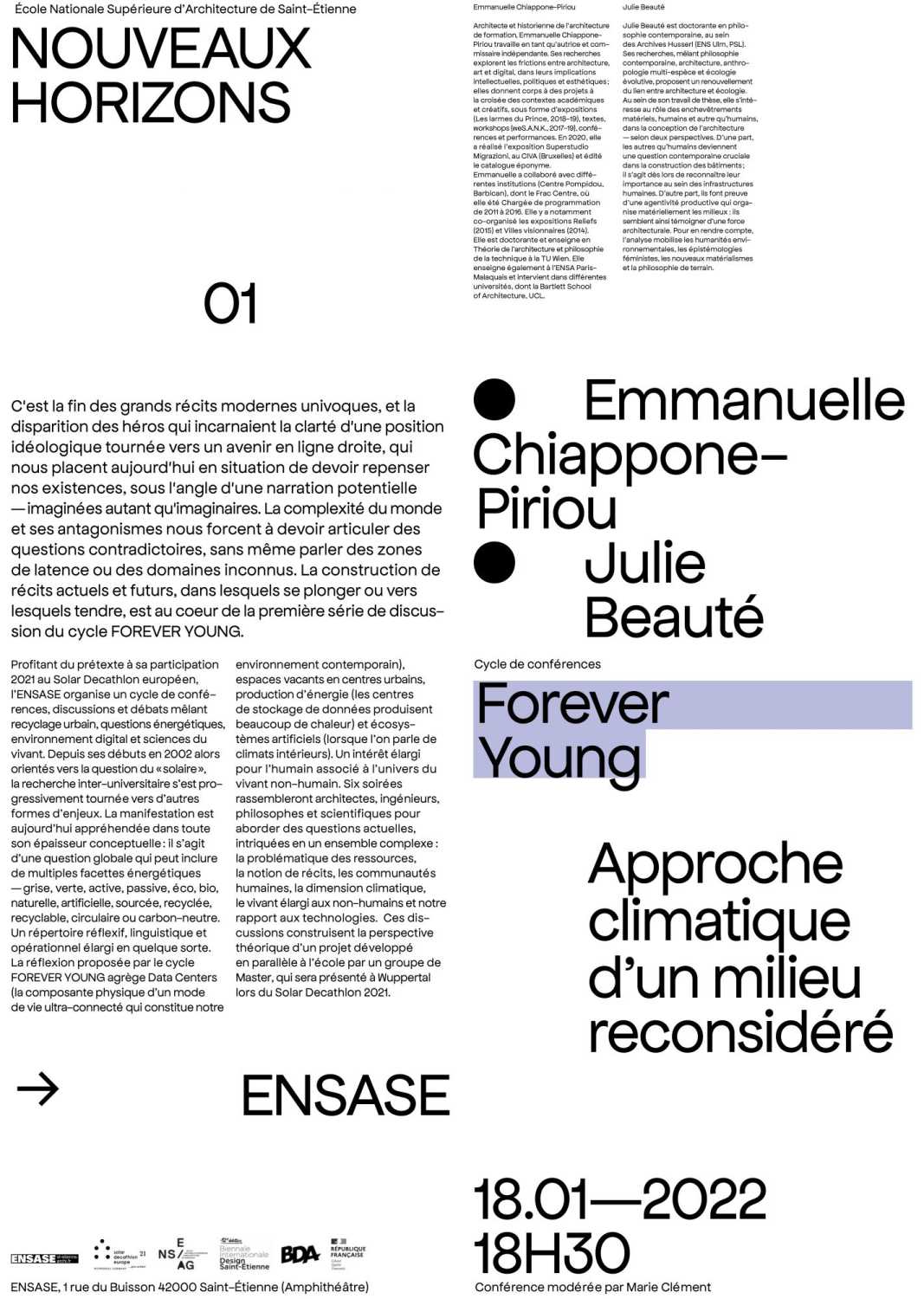
Profitant du prétexte à sa participation 2021 au Solar Decathlon européen, l’Ensase organise un cycle de conférences, discussions et débats mêlant recyclage urbain, questions énergétiques, environnement digital et sciences du vivant : Forever young.
La réflexion proposée par le cycle Forever young agrège Data Centers (la composante physique d’un mode de vie ultra-connecté qui constitue notre environnement contemporain), espaces vacants en centres urbains, production d’énergie (les centres de stockage de données produisent beaucoup de chaleur) et écosystèmes artificiels (lorsque l’on parle de climats intérieurs). Un intérêt élargi pour l’humain associé à l’univers du vivant non-humain. Six soirées rassembleront architectes, ingénieurs, philosophes et scientifiques pour aborder des questions actuelles, intriquées en un ensemble complexe : la problématique des ressources, la notion de récits, les communautés humaines, la dimension climatique, le vivant élargi aux non-humains et notre rapport aux technologies. Ces discussions construisent la perspective théorique d’un projet développé en parallèle à l’école par un groupe de Master, qui sera présenté à Wuppertal lors du Solar Decathlon.
En direct à distance sur la chaîne Youtube de l’Ensase
Nouveaux Horizons – 18 janvier 2022
Emmanuelle Chiappone-Piriou – architecte curatrice TU Wien (sur Techno-Utopia, superstudio, technologie et le vivant)
* Julie Beauté – philosophe (sur la question « esthétique du vivant/esthétique de l’échange ») + Marie Clément
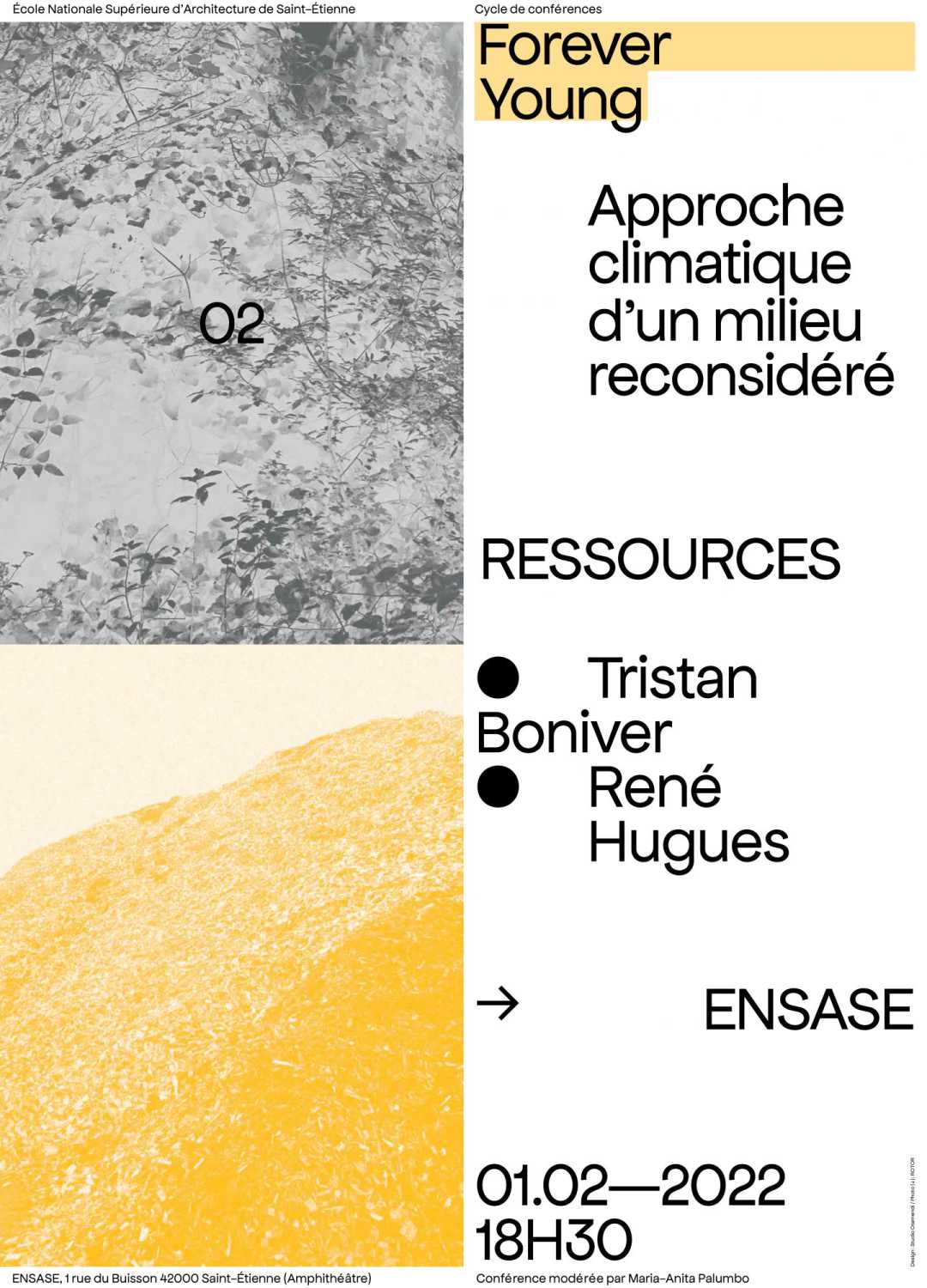
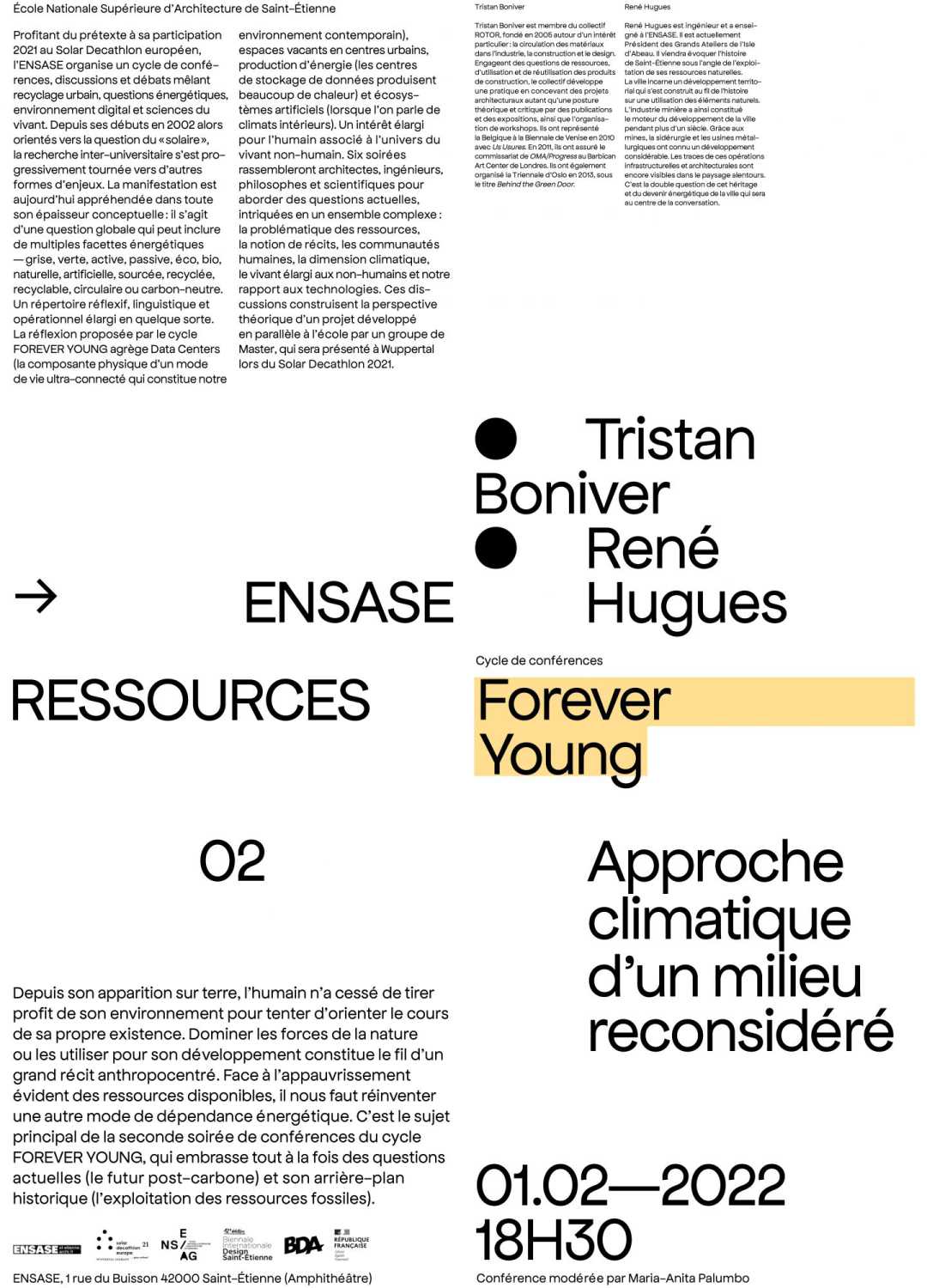
Exposition et colloque



Composite

Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.
Veuillez effectuer une mise à jour.

