Faire, encore, la conférence Art Design Recherche (AD•REC)
2025, aura lieu à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne
(Esadse) à la Cité du design durant la Biennale Internationale Design
Saint-Etienne, dont la 13e édition a pour titre : Ressource(s), présager demain.
Elle comporte deux volets :
- une exposition du 22 mai au 6 juillet 2025
- un colloque les 27 et 28 mai 2025
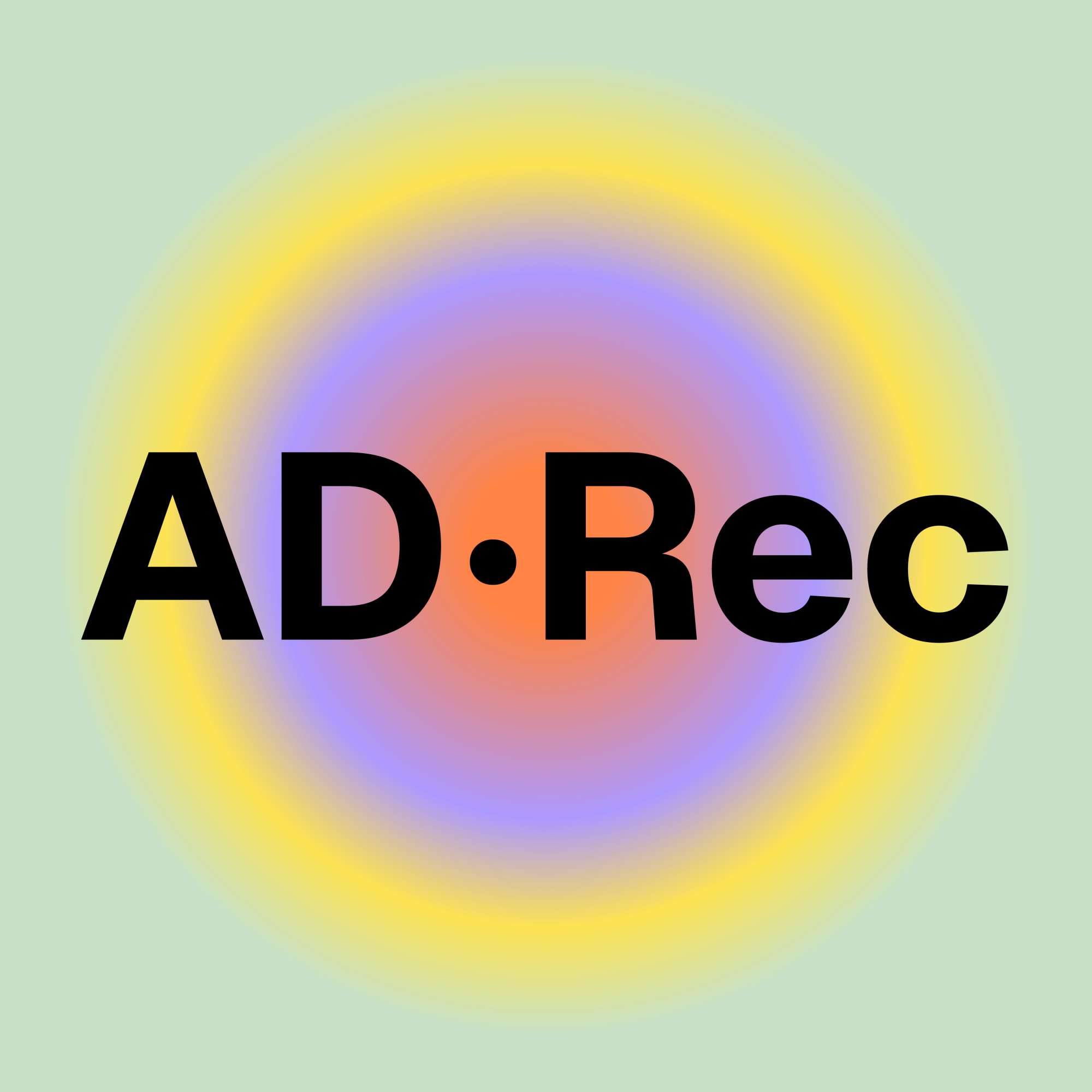
Faire, encore, la conférence Art Design Recherche (AD•REC) 2025, aura
lieu à l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne (Esadse) à
la Cité du design durant la Biennale Internationale Design
Saint-Etienne, dont la 13e édition a pour titre : Ressource(s), présager demain.
AD·Rec offre un panorama désormais régulier de la recherche créative.
Initiée et soutenue par le ministère de la Culture, AD·Rec 2025, Faire, encore est la seconde édition, après Limit / No Limit, en 2024 à Paris sous l’égide de l’ENSCI et de l’ENSBA Lyon.
Faire, encore
Penser, c’est toujours expérimenter, non pas interpréter, mais expérimenter, et l’expérimentation, c’est toujours l’actuel, le naissant, le nouveau, ce qui est en train de se faire.
Gilles Deleuze, Pourparlers, 1990
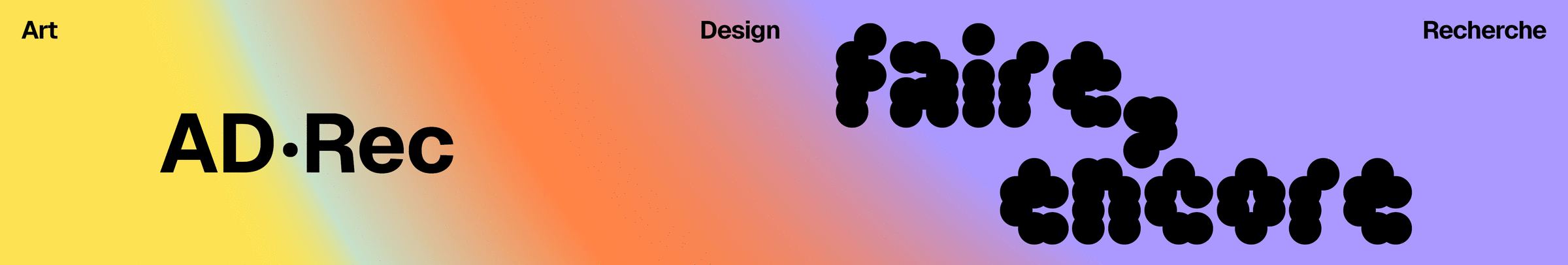
Questionner les « façons de faire » de la création actuelle
AD•Rec 2025 se propose de réunir des recherches menées principalement dans les écoles d’art et de design, et qui examinent les pratiques actuelles et les modalités de fabrique.
L’enjeu de l’exposition et du colloque est de dégager les valeurs du faire dans la création, ses conditions, et ses formes d’efficacité dans des milieux de vie en transformation, et de mettre en commun les connaissances scientifiques élaborées par les équipes. L’intention est de capter la tension qui se cristallise autour de l’empreinte des choses. Sur la surface terrestre, le poids des constructions humaines est désormais supérieur au poids de la biomasse. Comment arbitrer entre l’urgence vitale d’alléger, de ménager, de nettoyer, et l’appétit d’objets signifiants et beaux ?
La recherche des écoles offre un panorama d’expérimentations auxquelles les préoccupations et engagements des étudiant·es ne sont pas étrangers. Grandissant dans des milieux de vie mis à l’épreuve par les inéquités géopolitiques et les injustices climatiques, ils, elles et iels font face à de premiers stades d’inhabitabilité : la ville à 50°C, le manque d’eau, les inondations destructrices, la sixième extinction de masse. La situation pousse à imaginer les objets et les signes qui donneront du sens à des manières encore inconnues de faire, de vivre et d’être, au travers de tous les médiums, plastiques, picturaux, graphiques, numériques, visuels. Les expériences de faire autrement, faire ailleurs, faire avec – avec ce qu’on a, avec qui on veut, avec les autres, avec modération, avec soin – foisonnent dans les écoles d’art et design, les écoles d’architecture, les pôles universitaires, les écoles d’ingénieurs et les écoles de management. La recherche des écoles se trouve engagée dans les tentatives de régénération des milieux de vie.
AD•Rec 2025 rassemble et confronte les notions et concepts, les attitudes et valeurs, les méthodes et techniques. Cette mise au jour est animée par la conviction que la création est essentielle à des idéaux et images qui préparent les transformations, et qu’elle en est même la source.
Axes thématiques
Artistes et designers se donnent-ils des conditions pour créer des formes nouvelles dans un monde saturé d’objets ? Peut-on formuler ces conditions et en donner des exemples ?
Un monde même surchargé a besoin d’objets nouveaux, qui donnent du sens et une esthétique à l’époque. Quelles règles éthiques ou techniques se donnent les créateur·ice·s ? Quels arbitrages sont à l’œuvre ? On pense bien sûr au respect des normes environnementales et des pratiques de recycling, upcycling, récupération, diminution de matière, à la redevabilité et à la transparence dans l’usage des matières, des énergies et des infrastructures, au low tech, à l’open source, au permacomputing …
On voit aussi des inspirations venues d’un sens de l’intérêt général : la philosophie des commons, le respect de toutes les formes de vie, la sensibilité au territoire et au local, le travail sur les archives et la création dite documentaire, la reconnaissance des vulnérabilités, la dénonciation des discriminations. Ces attitudes et pratiques sont-elles à la source d’une esthétique ? Provoquent-elles des renoncements ? Quelle pensée critique quant aux dépendances aux environnements industriels et économiques, et à la persistance de dominations de fait, à l’embrigadement involontaire de mains invisibles par les infrastructures de la recherche créative au moment même où la création en mûrit la critique ?
Mots-clés : recycling, upcycling, récupération, diminution de matière, redevabilité, transparence, énergies, infrastructures, infrastructures, code, algorithme, donnée, low tech, open source, communs, coopérations, intérêt général, local, héritages, archives, documentation, savoirs vernaculaires, vulnérabilités, discriminations, dominations, altérité, care.
Quelle agentivité caractérise le travail créateur des arts et du design ?
Agir par la création n’est pas simplement dépendant d’un artefact. Intéressons-nous aux dimensions performatives, symboliques, relationnelles, politiques en amont et en aval de la production. La performativité du graphisme, incorporée dans les conduites routinières, définit sémiotiquement les usages de l’espace et son intelligibilité. Cela joue dans l’expression de l’autorité, par exemple le pouvoir d’une signalétique urbaine, ou en résistance, avec l’objet manifeste, la performance activiste, la portée critique et de contre-pouvoir que peuvent signifier une architecture éphémère, une œuvre numérique, une image. La seule inscription, non fonctionnelle, fabrique un territoire symbolique, et donne forme à l’expérience d’autrui en restituant une présence inter-subjective qui ne passe pas par le langage verbal.
Des artistes œuvrent à un “non-doing” et “non-making”. Ce n’est pas “un rien”. C’est un acte. Il pose le non-faire comme un refus de s’inscrire dans un ordre du monde que l’on désapprouve. Il réagence du “déjà fait” et “déjà là”, archives ou choses. De plus, les pratiques performatives sont adressées. Elles agissent sur les publics. Comment se diffuse leur pouvoir de transformation ? Comment sont-elles réappropriées, détournées, traduites, mises en circulation et en actes ? Les formes performatives apportent-elles une expression adaptée à l’état du monde présent ? En quoi les étudier enrichit-il la compréhension de l’agentivité du travail créateur et de sa création, généralement et spécifiquement aujourd’hui ?
Mots-clés : performativité, symbolique, agentivité, appropriation, œuvrer, relations, politique, artefact, manifesto, non-doing, non-making, agencement, éphémère, activisme, signalétique, lignes d’erre, signe, dessin, nouveaux énonçables, non visible, non connu.
Ce que les arts et le design font aux industries. Ce que les nouvelles fabriques font à aux arts et au design.
Que produisent les arts et le design ? Quelles transformations effectives opèrent-ils ? Alors même que les approches créatives s’intéressent aux mutations sociales qu’impose la profondeur des transformations de la vie, l’industrie prépare sa redirection. On donne ici à industrie le sens d’activité humaine industrieuse et tournée vers l’amélioration de la vie. Dans ce sens, aux usines s’ajoutent les micro-fabriques, les fermes, les collectifs artisanaux… Quels rôles de médiation ou d’instigation les métiers des arts, du design, de l’architecture jouent-ils dans la réinvention de la vie sociale, de la vie quotidienne, de la vie de travail, comme d’activités industrielles, scientifiques, artisanales ? On peut penser aux objets, procédés, infrastructures qui répondent à de nouveaux besoins, marchés et normes ; aux apports spéculatifs et imaginatifs des artistes et designers en laboratoire ; aux résidences et incubations, incluant les mondes ruraux et les compagnonnages.
Dans quelles directions évoluent les systèmes de production alternative ? Quel impact ont ces domaines d’activité sur les trajectoires des designers et artistes ? Des recherches sont-elles en cours sur de nouvelles professionnalités ? L’expérience des milieux fait-elle évoluer les artistes et des designers vers la recherche technologique, biotechnologique, écologique, historique et anthropologique, ou tout autant vers l’activisme ?
Mots-clés : milieux de vie, industries, redirection, mutations, transformations, médiation, effectivité, artisanat, micro-fabriques, fermes, mondes ruraux, compagnonnages, résidences, incubations, objets, procédés, infrastructures, laboratoires, imagination, trajectoires, professions.
Par infrastructures théoriques, on entend l’apport des savoirs historiques et de la pensée philosophique à la réflexion sur la fabrique (technique) et sur l’agentivité (transformatrice).
Comment sont interprétées dans les écoles d’art et de design les théories esthétiques, de l’architecture ou des techniques ? Dépasse-t-on, dans les enseignements, la quête de références et de modèles peut-être exposée aux pièges des analogies ? Sans doute. Comment alors caractériser avec ces appuis le faire contemporain ? S’en trouve-t-il pluralisé, décentré ? Peut-on ainsi aider à mesurer si l’environnement historique actuel le rend singulier ? On peut, symétriquement, se demander si ce faire contemporain apporte des voies de renouvellement à l’esthétique et au domaine Arts et Industries.
Le colloque s’enrichirait également de contributions s’intéressant aux combinatoires interdisciplinaires, par exemple avec les sciences des matériaux, les sciences du vivant ; les sciences écologiques, les sciences de la terre ; l’anthropologie, les sciences politiques et les études critiques du colonialisme et des études de genre en ce premier quart du XXIe siècle.
Dans une approche historique, des études concernant les apports des précédentes interventions des arts et du design dans la critique des industries, en esthétique et dans la recherche formelle, seront aussi attendues. Comment interpréter – et réutiliser au mieux – les appuis pris sur des mouvements, des groupes, des écoles pour en faire quelque chose au présent, alors même que nos circonstances environnementales spécifiques excluent les simples analogies ou la quête de modèles ?
Enfin, quel dialogue existe au sein des écoles, ou dans le cadre des événements de recherche et d’exposition, entre équipes de recherche et étudiant·e·s ?
Mots-clés : théorie critique, histoire, futur, avenir, utopies, spéculations, sociétés, apprentissages théoriques, perspectives.
Exposition du 22 mai au 6 juillet 2025
Lien vers l’article de l’exposition sur le site de la Biennale
Colloque 27 et 28 mai 2025
Programme des journées en construction (disponible le 15 avril 2025)
Informations pratiques
Lieux
La Platine
1 au 3 Rue Javelin Pagnon
42000 Saint-Étienne
Tram : Cité du design
Inscription et réservation
Contact
Vous pouvez adresser vos questions à adrec.bid2025@esadse.fr
Conseils et Comités
Ministère de la Culture
Solène Bélanger
Camille Herfray
Estelle Pagès
Ubavka Zaric
Éric Jourdan (Directeur Général EPCC Cité du design-Esadse)
Cléa Di Fabio (Cheffe de projet AD-Rec 2025)
Sophie Pène (Commissariat scientifique- exposition et colloque)
Rodolphe Dogniaux (Scénographe AD-Rec 2025)
Support Esadse :
Magali Coué (Directrice Stratégique)
Sandra Jacquier (Chargée de développement – Vie étudiante et Recherche)
Inge Eller (Chargée des programmes européens et internationaux)
Alix Diaz (Responsable administrative et
financière Esadse)
GRAD (Groupe de recherche en arts et design, ESAD Saint-Etienne)
David-Olivier Lartigaud (Random(Lab))
Jean-Claude Paillasson (IRD : Images-Récits-Documents)
Simone Fehlinger (Spacetelling)
Karim Ghaddab (LEM : Laboratoire d’expérimentation des modernités)
Rodolphe Dogniaux (Labo d’Objet)
Armand Behard (ENSCI, Paris)
Gwenaëlle Bertrand (UJM, Saint-Étienne)
Nicolas Bourriaud
Claire Brunet (ENS, Paris-Saclay)
Indiana Collet Barquero (Esad, Limoges)
Dominique Cunin (Esad, Valence et ENSAD Lab, Paris)
Rodolphe Dogniaux (Esadse, Saint-Étienne)
Davide Fornari (ECAL, Lausanne)
Sylvia Fredriksson (Esad, Orléans)
Sylvain Gouraud (ESADHar, Le Havre)
Claire Jacquet (EESAB, Bretagne)
Émilie Perotto (Esadse, Saint-Étienne)
Océane Ragoucy (ENSA, Paris-Malaquais)
Noémie Sauve (Esad TALM, Le Mans)
Emmanuel Tibloux (ENSAD, Paris)
Antonella Tufano (Université Panthéon-Sorbonne, Paris 1)
Pierre Lévy (CNAM, Paris)
Géraldine Longueville (ÉESI, Poitiers)
Yann Aucompte
Emmanuelle Becquemin
Armand Behar
Gwenaëlle Bertrand
Claire Brunet
Céline Caumon
Anne-Cécile Cochet
Indiana Collet-Barquero
Cléa Di Fabio
Rodolphe Dogniaux
Jérémie Elalouf
Maxime Favard
Davide Fornari
Sylvia Fredriksson
Elen Gavillet
Karim Ghaddab
Sylvain Gouraud
Gregory Granados
Estelle Guerry
Florian Harmand
Delphine Hyvrier
Sandra Jacquier
David-Olivier Lartigaud
Pierre Lévy
Géraldine Longueville
Ernesto Oroza
Jean-Claude Paillasson
Sophie Pène
Émilie Perotto
Océane Ragoucy
Jacopo Rasmi
Émeline Roy
Valentin Sanitas
Noémie Sauve
Seurat Clémence
Marie-Aurore Stiker-Metral
Marie Tesson
Antonella Tufano



Composite

Pourquoi continuer à produire des objets aujourd’hui ?
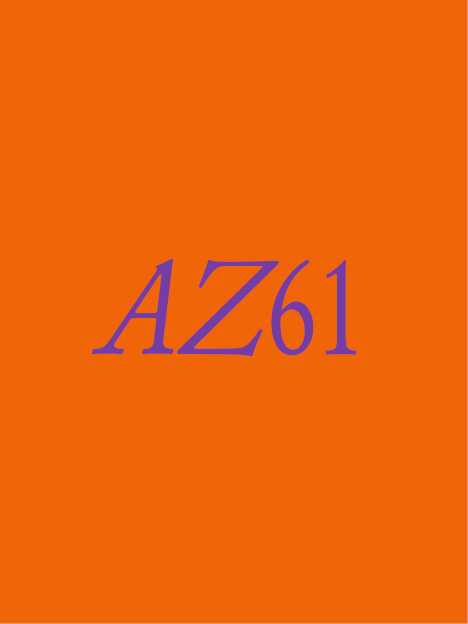
Votre navigateur est obsolète, l’affichage des contenus n’est pas garanti.
Veuillez effectuer une mise à jour.